| | |
De l’individualisme bienveillant à l’altruisme combatif.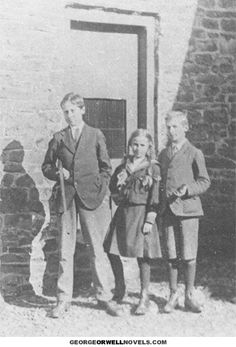 Après lecture de quelques uns des textes d’un prénommé Eric et de sa biographie par Bernard Crick j’ai osé me mettre dans sa peau. Voici : Je m’appelle Eric, je suis anglais. Je suis grand, trop grand. Ne mettant pas plié suffisamment dans les tranchées espagnoles une balle franquiste traversa ma gorge, heureusement sans toucher les carotides, me laissant une voix ébréchée. J’ai toujours souhaité vivre tranquille dans un de nos villages, jardinant, allant au pub et à la pêche. Cette dernière je l’ai décrite dans mon roman « Un peu d’air frais ». C’est l’histoire d’un agent en assurance qui s’échappe de sa routine pour retourner sur les traces de son enfance, revivant ses parties de pêche. Pour passer inaperçu voulant me couler dans le moule je servais la messe d’un pasteur que j’appréciais. Pas toujours facile pour moi l’incroyant. J’ai même demandé à un ami comment se passe une confession. Dans les années 20 30 il était bizarre dans nos campagnes de ne pas y passer. Avoir la foi ou pas, et la perdre, ces états d’âme je les ai décrits à la fin du roman « Une fille de pasteur ». Nous sommes tous contradictoires, il faut que je bouge et donc quitter mon village. Je suis au fond de moi-même révolté contre toute injustice. Ce qui m’a jeté ainsi dans la guerre d’Espagne en 36, ou comme reporter de guerre sur le continent en 1944. Mais commençons par le début. Je suis né en Inde en 1903 d’un père fonctionnaire au service de l’opium. En 1904 ma mère retourna en Angleterre nous emmenant moi et mes deux sœurs. Je classe ma famille dans la partie inférieure de la classe supérieure. Cette catégorie qui voudrait se la jouer haute mais qui n’en a pas les moyens. La qualité de mon travail scolaire et la position de mon père m’ont permis d’entrer dans une école privée de bachotage. Mais avec une bourse, ce que m’a fait comprendre la teigneuse femme du directeur. On y apprenait surtout un savoir utile aux concours d’entrée des grandes écoles, mais sans réflexion. Comme vous dites c’était du bachotage, dont les résultats comptaient pour la renommée de l’école. Pour ma part j’ai tenté le concours d’entrée d’Eton et me suis trouvé sur une liste d’attente. J’avais toutes mes chances nous étions en 1917 les garçons partaient dorénavant tôt pour l'armée. L'hémorragie avait atteint son maximum et les fournitures en «matériel officier valable» commençaient sérieusement à diminuer. Je garde un assez bon souvenir de ces années à Eton. J’y ai peu travaillé, passant graduellement du statut d'élève brillant à celui d'élève médiocre, et faisant montre d'un tempérament volontiers rebelle , une rébellion intuitive contre cette organisation en classes sociales. À cette époque, j’avais deux ambitions : devenir un écrivain célèbre et aller en Orient. Je m’essayais à des nouvelles et des poèmes publiés dans une revue du collège. Nous vivions dans un monde irréel qui, je crois, nous rendait peu désireux de regarder plus loin. Dans la chapelle, la liste de ceux qui étaient morts au combat s'allongeait de plus en plus : sur les 5 687 Etoniens qui avaient été appelés : 1 160 furent tués et 1 467 blessés, une proportion extrêmement élevée de morts par rapport aux blessés mais aussi par rapport au nombre d’appelés : ce style d’officiers chargeaient à la tête de ses hommes. Nous, les adolescents, prenions bien sûr les choses à leur mesure et n'avions aucune expérience qui nous aurait permis de dissocier le normal de l'anormal. ... Si vous distinguez vos véritables souvenirs de leurs modifications ultérieures, vous découvrez qu'en général ce ne furent pas les grands événements qui vous ont troublés à l'époque. Par exemple, je ne crois pas que la bataille de la Marne eut pour le grand public cet aspect mélodramatique qu’on lui attribua par la suite. De ces années de guerre, il me reste surtout le souvenir des épaules carrées, des mollets saillants et du tintement des éperons des artilleurs, dont les uniformes me plaisaient plus que ceux de l'infanterie. Parmi les très jeunes, des réactions pacifiques s'étaient développées bien avant la fin de la guerre. Être le plus détaché possible pendant les parades et n'éprouver aucun intérêt pour la guerre était considéré comme une marque d'intelligence. A dix-sept dix-huit ans, j'étais à la fois snob et révolutionnaire. J'étais contre l'autorité, j'avais lu et relu toute l'œuvre disponible de Shaw, Wells et Galsworthy (alors encore considérés comme des auteurs dangereusement avancés). Je m'affirmais socialiste. Bien que je ne saisissais pas très bien ce que le socialisme signifiait. Je n'avais aucune notion de l'existence d'êtres humains dans la classe ouvrière. Je pouvais m’attrister sur leurs souffrances par l'intermédiaire de livres, comme le Peuple des abysse de Jack London, mais chaque fois que je me trouvais à leur contact je les détestais et faisais semblant de ne pas les voir. J'étais toujours révolté par leur accent, et leur coutumière grossièreté me rendait furieux. J'ai l'impression d'avoir passé mon temps moitié à dénoncer le système capitaliste, moitié à pester contre l'insolence des receveurs d'autobus. Sortie d’Eton je m’engageais dans la police impériale en Birmanie. J’y appris graduellement à réprouver l'impérialisme. J’y accomplis ma fonction avec dégoût. Je reconnais que l’on me laissait tranquille. L’armée britannique et les services coloniaux étaient habitués aux solitaires excentriques qui lisaient des livres et ils se montraient relativement tolérants à notre égard. Dans les postes éloignés, c'était la seule chose à faire si l'on ne voulait pas sombrer dans l'alcool, là débauche ou - ce que l'on craignait par dessus tout - l'opium. Un jour j'ai assisté à la pendaison d'un homme ; cela me parut pire qu'un millier de meurtres. Je ne suis jamais entré dans une prison sans sentir que ma place était de l'autre côté des barreaux. Il ne s'agissait pas de la culpabilité ou de l'innocence des détenus mais de leurs souffrances inutiles endurées sous un système despotique dirigé par des étrangers. Quand je vis un condamné à mort allant vers la potence s'écarter pour éviter la flaque d'eau, je compris le mystère, le mal inqualifiable qui consiste à abréger une vie en pleine force. Cet homme n'était pas en train de mourir, il était aussi vivant que vous et moi à cette époque. C’est curieux, mais jusqu'à ce moment, je n'avais jamais réalisé ce que signifie détruire un homme conscient et en pleine santé. Mon poste suivant était dans une plaine alluviale : plate, vide, avec des mangliers, des rizières, le tout infesté de moustiques et puant le pétrole. Tout ceci aurait pu être supportable si seulement nous admettions sans faire de baratin que nous sommes des voleurs et que nous continuons à voler. Dans mon roman Une affaire birmane je décris un peu la vie de ces anglais alcoolisés tout en préférant ne pas idéaliser les autochtones. J’aurais pu dire comme Mark Twain : «Que Dieu damne les juifs, ils sont aussi mauvais que nous ! De retour sur le sol anglais je décidais rapidement de démissionner. En 1928 je tentais de vivre de ma plume à Paris. J’y vécus pendant des mois parmi les pauvres et des individus à demi délinquants qui habitaient les pires parties des quartiers les plus pauvres. A cette époque je me rapprochais d'eux par le manque d'argent, mais par la suite leur façon de vivre m'intéressa énormément pour elle-même. Pour survivre je fis la plonge dans les cuisines des grands restaurants, vivant dans des garnis où j’y côtoyais les punaises de lit qui s’abritaient le jour dans les déchirures du papier peint. Le seul remède utile était d’entourer le lit de poivre moulu. A cette époque je me suis tourné vers les cas extrêmes, les parias de la société : les vagabonds, les mendiants, les criminels, les prostitués. Ils étaient les derniers des derniers et c'était avec ces gens que je voulais entrer en contact. Ce que je désirais profondément, c'était de trouver un moyen d'échapper au monde respectable hypocrite qui me collait à la peau. De retour en Angleterre j’acceptais une enquête auprès des mendiants et autres laissés pour compte allant de foyer en refuge toujours marchant car il était interdit de rester sous le même toit et de stationner trop longtemps au même endroit. Nous étions enfermés le soir dans des conditions d’hygiène déplorable et nourri d’une soupe insipide accompagné de pain couvert de margarine. De ces deux expériences j’en tirai un livre Dans la dèche à Londres et à Paris. Paradoxalement ces deux textes chacun de qualité moyenne prenaient une force en étant associés dans un même ouvrage. De ce vagabondage j’en ai illustré aussi « Une fille de pasteur » avec ce qui suit. Ils survivent par des travaux saisonniers comme la cueillette du houblon, tâche éprouvante dans des conditions climatiques difficiles et logés dans des cabanes insalubres ou encore la cloche dans les parcs londoniens. Je tentais ainsi de survivre par des essais et critiques littéraires et toujours avec le besoin de pouvoir me réfugier à la campagne améliorant l’ordinaire par le lait d’une chèvre, par quelques poules et un potager. Toujours traînant des problèmes pulmonaires qui, par une tuberculose, eurent raison de moi. Mes premiers écrits de journaliste furent plus proches de mon style final que mes romans du début. Je considérais le style journalistique comme un simple travail alimentaire. Il me fallut quelques années pour comprendre que je possédais déjà quelque chose de bien plus fin que ce style littéraire que je recherchais. Il est vrai qu’il était difficile de publier des textes au style direct avec les expressions populaires, les jurons et grossièretés car sévissait une censure officielle, qui provoquait une auto censure. Tous ces F... deviennent de véritables blancs et nous avertissent des ennuis que pourraient attirer tous les détails sur la crasse des marchands de café ambulants et des hôtels de l'Armée du salut. Mon agent me donna une liste précise de toutes les modifications qu'il voulait voir apporter dans le livre. Les noms à changer, les jurons à couper. Mes doutes sur la qualité de mes premiers essais m’incitèrent à choisir un pseudo, pensant sortir vierge pour mes créations littéraires futures. Ce pseudo et mes derniers livres ont occultés mes autres écrits. Dommage beaucoup d’écrivaillons pourraient en être fier. C’est en janvier 1936 que la canaille d’éditeur Victor Gollancz m’a poussé à devenir un écrivain politique. Il m’a interrompu dans le cadencement annuel de l’écriture de romans en me commandant un livre sur les conditions de vie des chômeurs et des mineurs dans le nord industriel de l'Angleterre touché par la crise. Avant ce voyage dans le nord je n'avais jamais vu une région industrielle de ma vie, ni jamais vu une grande cheminée d'usine ou une cheminée de houillère fumer. En arrivant sur place j’eus la bonne intuition, la curiosité et l'humilité de vivre avec les gens ordinaires et non de descendre à l’hôtel comme c’était habituel pour mes collègues journalistes. « C’est pas bien riche ici, me dirent-ils, mais on reçoit confortablement nos invités. - On dit que nous sommes sales, nous les ouvriers, mais c’est pas facile, il n’y a pas moyen dans toutes les mines de se nettoyer et nous rapportons à la maisons la poussière du charbon. - Nous, les mineurs, sommes quand même fiers. Et même au chômage nous briquons notre maison. Tout le monde si met, même les hommes. » Pourtant Mrs Meale, mon hôtesse, à qui je lui ai proposé de faire la vaisselle, mal à l'aise m’a répondu «Les garçons ici s'attendent à être servis ». Pour descendre au fond c’est Mister Jerry Kennan qui a arrangé la chose. Il devait électrifier le puits surnommé à juste titre le Goulot. On m'équipa d'un casque et d'une lampe et on prit la galerie principale dans laquelle on pouvait se tenir debout, mais dans le chemin je me cognais contre le plafond affaissé. Je n’avais pas baissé la tête assez rapidement. Malgré le casque je m’écroulais à en être groggy. Je réussi à me mettre sur pieds et on reprit le chemin. Plus on avançait plus le plafond était bas et j’ai bien parcouru cinq cents mètres complètement replié sur moi-même. A l'arrivée j’étais incroyablement fatigué. Je me suis étendu à même le sol sur le charbon. J’ai observé les gars bosser torse nu dans cette chaleur et la poussière, à tirer le charbon extrait par les machines pour remplir les wagonnets. En sortant du puits, j’étais épuisé mais je retrouvais suffisamment de force pour boire un verre avec les mineurs dans un pub voisin. Dans ces pubs et chez les militants je participais à toutes sortes de discussions politiques, sans cacher qui j’étais. Je voulais découvrir l'état d'esprit et les pensées des mineurs et les ouvriers au chômage. Avec ce reportage je ne peux pas comprendre ni expliquer vraiment ce qui s'est passé alors. Mon écriture et mon comportement, dire mes amis, changea étonnamment. Ça couvait en moi et brusquement m’embrasait. A sa sortie mon livre, Le quai de Wigan constituait, pour un vieux militant des mines, à ses yeux un brillant morceau de propagande ; pour lui elle était «belle» parce qu’elle « disait la vérité» sur les mines de charbon, avec beaucoup de sensibilité et de détails précis bien que je ne sois descendu que trois fois dans la mine. Ces expériences accrurent ma haine naturelle de l'autorité et me donna pour la première fois pleine conscience de l'existence de la classe ouvrière ; mon travail en Birmanie m'avait procuré une certaine compréhension de la nature de l'impérialisme. Mais malgré ces expériences à la fin de 1935, je n'avais toujours pas réussi à me décider politiquement. La guerre d'Espagne et certains événements en 1936-37 renversèrent la situation et je sus alors où je me situais. Tout ce que j'ai fait de sérieux depuis 1936 a été écrit, directement ou indirectement, contre le totalitarisme et pour le Socialisme démocratique, tel que je le conçois. J’étais tout à fait engagé aux côtés du « Socialisme démocratique » avant même de partir pour l'Espagne, mais sans percevoir encore la notion du totalitarisme. Aussitôt l’annonce de la guerre civile en Espagne et de la tentative de Franco de renverser la république élue je voulu voir. Sur place je m’engageais dans le POUM (Parti Ouvrier d’Unification Marxiste). La milice dont je fis partie avait été assemblée à la hâte l'année précédente, dans les premiers jours de la mutinerie de Franco, par les syndicats et les partis politiques, et c'est à eux que les soldats faisaient allégeance, bien plus qu'au gouvernement central. En fait, le POUM était aussi opposé que les anarchistes, au contrôle de l'État centraliste. Et ils estimaient que le parti communiste était corrompu par le pouvoir de l'état. La Batalla, le journal du POUM, avait été le seul à dénoncer en Catalogne les procès de Moscou de juillet 1936 et l'exécution en août par Staline des « vieux bolcheviques ». La milice du POUM était, en théorie à tous les échelons, une démocratie sans hiérarchie, comme si chaque centuria constituait une commune ou un soviet. Il y avait bien des officiers et des sous-officiers qui donnaient des ordres et on s'attendait à ce qu'ils fussent exécutés ; mais on les donnait entre camarades en expliquant les tenants et les aboutissants. Ainsi, il n'y avait pas de grades dans le sens habituel, pas de titres, pas de galons, pas de claquements de talons et pas de salut. Tout le monde jouait le même rôle, avait la même nourriture, portait le même uniforme et vivait dans les mêmes lieux. Le point essentiel, c'était l'égalité sociale entre les officiers et les hommes. Tous vivaient sur le même pied d'égalité. Bien sûr, ce n'était pas l'égalité parfaite, mais je n'avais encore rien vu qui en approchait autant et je n'avais jamais pensé cela réalisable en temps de guerre … l’égalité fraternelle. J'ai vu des choses merveilleuses et c’est à ce moment que finalement je crus réellement au socialisme. Avant ce n'était que fait intellectuel et compassion pour la souffrance des autres. En Catalogne, je l'expérimentais moi-même et cessa d'être condescendant. Je fus plongé dans la camaraderie. Rien de ce qui se produira par la suite n'effacera cette expérience extraordinaire. La majorité des miliciens étaient jeunes et joyeux. Ils n’avaient pas l’air de deviner que moi l'étranger aux longues jambes, qui devait toujours se baisser dans les tranchées alors que les autres marchaient normalement, que j’étais un intellectuel, un écrivain qui notait tous les détails de son environnement. Nous partagions la vie en toute camaraderie, c’est tout. De retour du front pour permission à Barcelone je fus témoin de cette deuxième guerre civile par la répression contre le POUM. Me cachant la nuit et retrouvant le jour ma femme venue me rejoindre nous nous faisions passer pour des touristes. Nous décidâmes de fuir ce merdier mais au risque pour moi d’être arrêté comme déserteur, emprisonné pour un jugement jamais décidé me faisant pourrir dans les geôles de la république, si ce n’est pas finir fusillé. Prenant le train toujours comme de simples touristes nous passâmes les Pyrénées retrouvant la liberté de mouvement. De cette expérience mon analyse politique se précisa. Le franquisme était différent des nazi-fascistes. Il visait surtout au maintien d'un ordre rappelant la face sombre du moyen-âge. Le véritable combat en Espagne se jouait entre la révolution et la contre-révolution dans le camp du gouvernement. Je vais jusqu’à accuser la classe moyenne républicaine de pencher pour une paix séparée avec Franco de crainte que la victoire ne signifie la révolution. Si la guerre éclatait avec l'Allemagne ce serait un conflit purement impérialiste, un combat du capitalisme pour le contrôle des marchés. Le fascisme n'est après tout que le développement du capitalisme, et la démocratie la plus modérée, comme on dit, est capable de tourner au fascisme à la première morsure. Le mot que Mussolini avait utilisé en s'en glorifiant, le «totalitarisme», les vrais socialistes s'en servirent pour désigner l'unique dessein des autocraties modernes. Le gouvernement britannique lui s'intéressait plus à combattre le communisme et le socialisme que le fascisme. Nous aimons dire que l'Angleterre est une démocratie, mais notre façon de diriger l'Inde est aussi mauvaise que le fascisme allemand. A mon retour en juillet 37 je découvris chez nous une campagne de calomnie contre le POUM et donc contre moi, mais s’étouffa après mes menaces de procès. Ensuite entre 37 et mon décès en 1950 suivirent écritures, émissions de radio, sanatoriums, engagements défavorables puis favorables au réformisme des travaillistes comme un pis-aller devant ma peur du stalinisme. Ce que j'ai surtout voulu dans mes dernières années, c'est faire de l'écrit politique un art. Mon point de départ est toujours la partialité, le sens de l'injustice. Quand je commence à écrire un livre, je ne me dis pas « Je vais produire une œuvre d'art. », j'écris parce qu'il existe un mensonge que je veux montrer, un fait sur lequel je veux attirer l'attention, et mon but initial est d'être entendu. Mais je ne pourrais effectuer ce travail d'écriture, s'il ne s'agissait en même temps d'une expérience esthétique. Quiconque daigne regarder de près mon travail verra que même lorsqu'il s'agit de pure propagande, il y a beaucoup de ce qu'un homme politique considère comme inutile. M'occuper du style et aussi aimer la surface de la terre, prendre plaisir aux objets et bribes d'informations jugées futiles. Mais je m’arrête là. A ce rythme j’en ai bien encore pour un quart d’heure. Je vous laisse découvrir la suite dans mes romans, essais et articles. Je ne pensais pas partir de ce monde si vite. Mes amis n’y croyaient pas m’ayant vu rebondir si souvent. Je me suis acheté un super lancer pour tâter de la truite. J’espère que Richard, mon fils adoptif, l’utilise. Si vous passez par Sutton Courtenau Berkshire venez au cimetière, apportez une bonne pinte ou un thé fort comme je les aime. Nous trinquerons ensemble à votre santé, à la vieille Angleterre et au socialisme démocratique. Avril 2019 Haut de page Page en amont Des visites régulières de ces pages mais peu de commentaires. Y avez-vous trouvé ou proposez-vous de l'information, des idées de lectures, de recherches ... ? Y avez-vous trouvé des erreurs historiques, des fautes d'orthographes, d'accords ... ? Ce site n'est pas un blog, vous ne pouvez pas laisser de commentaires alors envoyez un mail par cette adresse Contacts Au plaisir de vous lire. |