| |
|
| Par
les films d'Hitchcock Liens vers des notions et des noms : Animalité, chute, Déconstruction de la pensée occidentale, Derrida, idée et forme, Lacan, musique, suspense, symbole Hichcock s'est trompé - Fenêtre sur cour - Contre-enquête Idées, formes et quelques films Les objets dans l’oeuvre de Hitchcock Magazine littéraire 447 de novembre 2005 Page 48 Par Emmanuel Burdeau «...[pour Éric Rhomer] «Idées et formes suivent la même route, et c'est parce que la forme est pure, belle, rigoureuse, étonnamment riche et libre qu'on peut dire que les films de Hitchcock, et vertigo au premier chef, ont pour objet - outre ceux dont ils savent captiver nos sens - les idées, au sens noble, platonicien du terme.» ... Moins claire, en revanche, son invocation de l'Idée. Si le texte définit la forme pure de Vertigo - la spirale ou l'hélicoïde, du chignon de Madeleine à l'escalier de la mission espagnole -, la seule idée qu'il évoque, et encore est-elle privée de majuscule, concerne le double personnage joué par Kim Novak : Scottie (James Stewart) n'aurait été amoureux que de l'idée d'une femme. ... «Comme dans la théorie platonicienne, l'Idée précède ici l'existence et la fonde.» La pensée critique dont nous avons tous hérité[e] reconnaissait donc trois types d'idées au cinéma. L'Idée abstraite et éternelle ; l'idée comme illusion ou fiction, qui contraint l'amoureux à être « continuellement renvoyé d'apparence en apparence » ; le principe directeur que porte en lui l'esprit créateur, lui assurant maîtrise et contrôle sur son art, quels que soient les scénarios médiocres que lui impose l'industrie. C'est bien sûr la deuxième qui nous concerne le plus. Là où Rohmer dit «idée», le réflexe serait aujourd'hui de dire « image ». Non pas en vertu d'un changement de vocabulaire, mais parce que Vertigo, à la fois sommet du classicisme et début de la modernité, marqua le moment où le cinéma est tombé du côté de l'image comme mentsonge ou leurre. ...Avec Deleuze, on pourrait dire que le cinéma n'a pas besoin de la philosophie ; ni la philosophie du cinéma. Reste que la critique a cru avoir besoin de Platon, et qu'une part considérable de son histoire loge dans la combinaison de deux platonismes. C'est pourquoi une des urgences actuelles pourrait être de continuer à se servir du philosophe. Certes pas pour asseoir une nouvelle conception unifiée du cinéma ; plutôt pour faire enfin l'examen de nos habitudes critiques.» Par le Philosophie-magazine : https://www.philomag.com/dossiers/dans-la-tete-dhitchcock «Alors qu’il n’était considéré que comme un bon artisan, de jeunes critiques français firent d’Hitchcock, dans les années 1950, un artiste, voire un philosophe. Éric Rohmer écrivit ainsi : « Idées et formes suivent la même route, et c’est parce que la forme est pure, belle, rigoureuse, étonnamment riche et libre qu’on peut dire que les films d’Hitchcock […] ont pour objet […] les Idées, au sens noble, platonicien du terme » (Les Cahiers du cinéma, n° 93, mars 1959)... comme l’a suggéré Žižek dans Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Lacan sans jamais oser le demander à Hitchcock (Capricci, 2010). Cette polarité entre métaphysique de la forme pure et psychologie des profondeurs anime toujours les interprétations des philosophes d’aujourd’hui.» publié le - Une femme disparaît {1938} «Dans le cinéma hitchcockien, il y a toujours une femme qui disparaît. Elle était là sous nos yeux, et soudain elle n’y est plus. C’est la réponse que le cinéaste donne à la question lacanienne : la Femme existe-t-elle ? Une femme apparaît lorsqu’un homme est capable de ne pas reculer devant ce continent noir. Iris, Marnie, Madeleine et les autres n’apparaissent que grâce au désir de savoir de l’Autre, qui sait les rattraper à temps. Le cinéaste est lui-même ce Cary Grant à la fin de La Mort aux trousses (1959), rattrapant au dernier moment Eva Marie Saint prête à chuter dans le vide. Hitchcock en ce sens est un homme qui aimait le caractère dangereux et évanescent de la féminité. Comme Freud, il aimait être celui qui rattrapait les femmes au bord du précipice pour les faire réapparaître dans toute la splendeur de leur être. »» Par publié le Soupçons {1941} « Dans ses entretiens avec Truffaut, Hitchcock définit ainsi le suspense : il y a suspense lorsque l’un des personnages ignore quelque chose qui le menace mais que les autres protagonistes et les spectateurs (nous-mêmes qui assistons à la scène) connaissent. De sorte que nous voudrions lui crier ce qu’il ignore et que les autres dans le film ne peuvent pas – ou ne veulent pas – lui dire. Ainsi, à la fin de La Mort aux trousses, Eve Kendall prépare ses valises dans sa chambre à l’étage sans savoir que les deux espions soviétiques en bas ont décidé de la tuer pendant le voyage, ce que nous avons entendu, ainsi que Roger Thornhill, qui, dehors, de l’autre côté des vitres, lance des cailloux contre les carreaux pour prévenir la jeune femme. Et elle ne l’entend pas, pas plus qu’elle ne nous entendrait si nous criions.... une tension croissante se met en place à la fin du film, qui nous prend au ventre aussi bien que le suspense au sens propre. Il faut du moins que nous soyons convaincus que la question possède une réponse. Mais pourquoi ? D’où vient-elle, cette croyance à un univers bien déterminé, dans le film et dans la réalité ? » Par publié le L’Ombre d’un doute {1943} « Dire qu’il faut prêter l’oreille au rôle que la musique joue chez Hitchcock, ce n’est pas une simple façon de parler. Car dans nombre de ses films, elle a littéralement un rôle à jouer, à l’égal des personnages. Comme si tout à coup elle s’animait. Comme si elle était dotée d’une âme et d’un mouvement. Comme si elle agissait de son propre chef.» Par publié le La Mort aux trousses {1959} «...immaturité et ... vulnérabilité proprement masculines sont un thème du film et en constituent l’intrigue absurde... La scène finale du film, sur le mont Rushmore – minuscules figures humaines courant sur les visages monumentaux (mais cadrables par la caméra, tout comme ceux des acteurs), taillés à même la montagne, des Pères fondateurs de l’Amérique – nous hante comme rappel de la possibilité permanente de la chute, une chute qui ferait pour ainsi dire tomber de la terre, inquiétante figure humaine, vers le néant. » Les objets dans l’oeuvre de Hitchcock - Symboles, marques et démarques au service du cinéma Par Pierre Barrette dans L’objet au cinéma Numéro 133, septembre 2007 https://www.erudit.org/fr/revues/images/2007-n133-images1108541/13529ac.pdf «Dans Rear Window, le voyeurisme de Jeff - l'un des thèmes fondamentaux par lequel le film soulève un questionnement éthique - s'exprime dans la série d'objets comportant des éléments d'optique qu'il convoque - d'abord un appareil photo, puis un téléobjectif, enfin des jumelles - dont on peut difficilement ne pas percevoir l'aspect ouvertement phallique. Cette évocation de la sexualité du héros est par ailleurs renforcée par l'usage d'un grattoir en bois dont il se sert à un moment du film - le geste suggère sans équivoque la masturbation - pour «soulager» les démangeaisons que lui cause sa jambe dans le plâtre, soulignant par ricochet son « impuissance ». Et lorsque Lisa exhibe à Jeffrey le jonc de mariage de la femme de Thornwall qu'elle vient de récupérer en s'aventurant dans son appartement, celui-ci représente en même temps qu'une preuve du meurtre le symbole de son propre triomphe, le signe qu'elle vient de gagner le bras de fer engagé depuis le début concernant l'éventualité d'un mariage avec Jeff. Voilà qui illustre, croyons-nous, ce que veut dire Deleuze quand il avance que la grande innovation de Hitchcock est de faire apparaître au cinéma une « nouvelle sorte de figures, les figures de pensées» et que, ce faisant, il inclut le spectateur dans le film. Car s'il y a un sens à dire de Hitchcock qu'il est peut-être l'un des premiers cinéastes modernes, en termes de chronologie sinon de rang, c'est bien dans la mesure où il a établi les conditions d'un renouvellement du cinéma, conditions qui, comme on vient de tenter de le montrer, passent par la nouvelle fonction qu'il confère aux objets.» Hichcock s'est trompé - Fenêtre sur cour - Contre-enquête de Pierre bayard 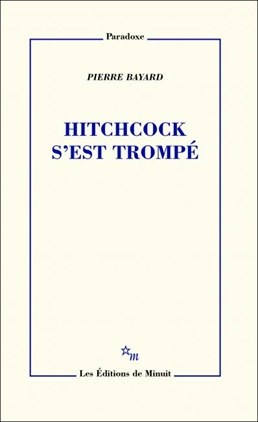 Éditions de Minuit (dont articles de presse). 4e de couverture et site de l'éditeur «Il est impossible de croire sérieusement, comme les deux héros du célèbre film d’Hitchcock Fenêtre sur cour, que leur voisin aurait tué sa femme, puis l’aurait découpée en morceaux devant les fenêtres ouvertes d’une trentaine d’appartements. Mais leur délire d’interprétation n’a pas pour seule conséquence de conduire à accuser un innocent. Il détourne l’attention d’un autre meurtre – bien réel celui-là – qui est commis devant les spectateurs à leur insu et mérite l’ouverture d’une enquête.» Un végan devrait comprendre l'attention portée sur cet autre meutre. Franceculture/podcasts/le-book-club/pierre-bayard-contre-enquete
«Et si une œuvre pouvait échapper à son créateur ? C’est le pari un peu fou que propose Pierre Bayard, professeur de littérature et psychanalyste dans son dernier ouvrage, Hitchcock s’est trompé “Fenêtre sur cour” contre-enquête. Connu notamment pour son anti-manuel Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ? (Minuit, 2007), Pierre Bayard a fait de la fiction interventionniste un genre à part entière, réouvrant les classiques pour en débusquer les interstices et en démasquer le réel assassin. Après Œdipe n'est pas coupable (2023), L'affaire du chien des *Baskerville (*2010) et Qui a tué Roger Ackroyd ? (1998), Pierre Bayard poursuit désormais l'enquête en terres de cinéma. Dans les pas de Jeff (James Steward) et Lisa (Grace Kelly) Pierre Bayard reprend point par point l’enquête qui conduisit, en 1954, les deux héros de Fenêtre sur Cour à conclure au meurtre de Mrs. Thorwald et à la culpabilité de son époux. Or dans cette affaire, le meurtre n’est peut-être pas celui qu’on croit et Hitchcock pas si avisé qu'il ne le croit. L'invention de la critique interventionniste "La critique policière fait partie d'une critique plus large que j'appelle la critique interventionniste, qui consiste, contrairement à la critique académique, à ne pas rester inactif face aux œuvres, mais à les améliorer, à les transformer, à les lire autrement, à devenir des intervenants, des intervenantes actives. Chaque œuvre a été précédée d'une multitude d'autres œuvres, et l'interventionnisme, est aussi ancien que la littérature elle-même. Par exemple, prenons le cas du Moyen Âge, les moines copistes, s’ennuient, alors, ils interprètent les textes, ils les complètent, ou au contraire, retirent un passage qui est en trop… C’est pour cela que vous n'avez pas de manuscrit original d'une œuvre médiévale. L’interventionnisme est général, et c’est ce qu’on appelle l’interpolation. Depuis lors, nous l’avons perdue, mais je me considère comme un écrivain médiéval." Pierre Bayard La question de Frédérique ... "Pierre Bayard est un auteur que j’aime beaucoup, je trouve ses livres intelligents, brillants, érudits, mais aussi inattendus et ludiques. Il a le goût du paradoxe et de l’ironie, et cela me touche. Son œuvre est à la fois hyper diversifiée, avec en même temps une grande unité de pensée. Alors voici ma question : Comment vous situez-vous dans le paysage littéraire français ? Êtes-vous un philosophe, un scientifique, un poète ?" Pierre Bayard : "En tant qu’écrivain, j’ai tenté de casser la frontière entre sciences humaines et fiction. Quand on prend de la fiction, on ne se demande pas « qui » ? Il est évident que Nabokov n’est pas le pédophile de Lolita. De même que le narrateur de Proust n’est pas Proust. Si vous prenez un ouvrage de sciences humaines, le 'je' qui écrit est à la fois le narrateur et l’auteur. Ce que j’ai essayé de créer, et ce qui s’est imposé à moi au fil des livres, c’est l’idée d’un "je" qui n’est pas moi, mais un narrateur assez paranoïaque, qui a plus ou moins fumer la moquette et qui formule un certain nombre d’énoncés avec une certaine rigueur caractéristique de la paranoïa. Donc, dans Hitchckock s’est trompé, le narrateur est clairement paranoïaque, comme l’est le raisonnement de Jeff et de Lisa. En fait, ce qui m’a intéressé, c’est de montrer la paranoïa ou le complotisme à deux niveaux différents."» Pages 142 et suivantes Réflexions par Derrida sur la construction de l'attention plus grande à la vie animal, par le regard face à la nudité. «... révolution intellecteuelle analogue à celle de Descartes mais en contradiction avec elle.» 143 Déconstruction de la pensée occidentale, toujours par Derrida, dont sa pensée a été prolongée par Anne Simon et la zoopoétique (p146). Haut de page Page en amont Des visites régulières de ces pages mais peu de commentaires. Y avez-vous trouvé ou proposez-vous de l'information, des idées de lectures, de recherches ... ? Y avez-vous trouvé des erreurs historiques, des fautes d'orthographes, d'accords ... ? Ce site n'est pas un blog, vous ne pouvez pas laisser de commentaires alors envoyez un mail par cette adresse Contacts Au plaisir de vous lire. |