| | |
| Nikolaïl Gogol Les âmes mortes 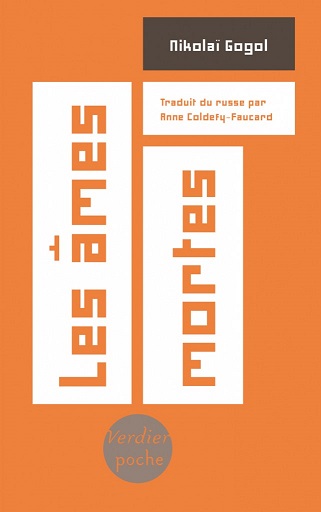 Éditions Verdier Texte en ligne http://bibliotheque-russe-et-slave.com/Gogol Les Ames mortes Pages du livre mais texte de la traduction ci-dessus. Page 22 L'ironie par la métaphore «En pénétrant dans la grande salle inondée de lumière, Tchitchikov dut un instant fermer ses yeux éblouis par le violent éclat des bougies, des lampes, des toilettes. Les habits noirs papillotaient, voltigeaient de-ci de-là, comme des mouches sur un pain de sucre que, pendant une chaude journée de juillet, une vieille femme de charge casse en morceaux étincelants près de la fenêtre ouverte. Les enfants qui l’entourent épient les mouvements du bras noueux qui lève le marteau, tandis qu’un essaim de mouches, tourbillonnant dans l’air léger, s’abat sur les friands morceaux, avec la complicité du soleil qui aveugle la vieille à la vue affaiblie. Rassasiées par les mets savoureux que leur prodigue l’opulent été, elles songent moins à manger qu’à se faire voir ; voletant sur le tas de sucre, elles frottent leurs pattes l’une contre l’autre, s’en chatouillent sous les ailes, passent sur leur tête celles de devant étendues, s’envolent enfin pour revenir bientôt avec de nouveaux escadrons importuns.» 169 à 171 Curiosité disparue de l'auteur. «Jadis, aux temps lointains de ma jeunesse, aux temps de mon enfance à jamais disparue, je me réjouissais en arrivant pour la première fois dans un endroit inconnu : hameau, village, bourg, pauvre chef-lieu de canton, — mon œil d’enfant trouvait partout de quoi satisfaire sa curiosité. ... Maintenant, j’approche avec une égale indifférence de toutes les propriétés inconnues. Je considère d’un œil morne leur écœurante banalité. Rien ne m’égaie ; tout ce qui jadis eût provoqué un jeu de physionomie, un éclat de rire, un flot de paroles, tout cela glisse devant moi, tandis que mes lèvres immobiles gardent un impassible silence. Ô ma jeunesse ! Ô ma candeur !» 202 à 204 Position de l'écrivain «Heureux l’écrivain qui fuit les plats caractères dont la trop réelle banalité rebute et accable, pour s’adonner à la peinture des âmes nobles, honneur de l’humanité ; qui, dans le tourbillon d’images continuellement changeantes, choisit quelques rares exceptions ; qui ne trahit jamais le ton élevé de sa lyre, ne s’abaisse point vers les humbles mortels et plane loin de la terre dans la région du sublime. Doublement enviable apparaît son sort magnifique : il se trouve comme en famille parmi ces êtres d’élite, et les échos de sa gloire retentissent dans tout l’univers. Il flatte et enivre les hommes en leur voilant la réalité, en dissimulant les tares de l’humanité pour n’en faire voir que la grandeur et la beauté. Tous lui battent des mains et font cortège à son char de triomphe. On le proclame grand poète, on affirme qu’il dépasse en génie les autres beaux esprits, comme l’aigle l’emporte sur tous les oiseaux de haut vol. À son nom les jeunes cœurs tressaillent, des larmes de sympathie brillent dans tous les yeux. Personne ne l’égale en puissance !... Un autre sort attend l’écrivain qui ose remuer l’horrible vase des bassesses où s’enlise notre vie, plonger dans l’abîme des natures froides, mesquines, vulgaires — que nous rencontrons à chaque pas au cours de notre pèlerinage terrestre, parfois si pénible, si amer, — et d’un burin impitoyable étale au grand jour ce que nos yeux indifférents se refusent à voir ! Il ne connaîtra pas les applaudissements populaires, les larmes de reconnaissance, les élans d’un enthousiasme unanime ; il ne suscitera nulle passion héroïque dans les cœurs de seize ans, ne subira pas la fascination de ses propres accents ; il n’évitera pas enfin le jugement de ses hypocrites et insensibles contemporains, qui traiteront ses chères créations d’écrits méprisables et extravagants, qui lui attribueront les vices de ses héros, lui dénieront tout cœur, toute âme et la flamme divine du talent. Car les contemporains se refusent à admettre que les verres destinés à scruter les mouvements d’insectes imperceptibles valent ceux qui permettent d’observer le soleil ; ils nient qu’une grande puissance de pénétration soit nécessaire pour illuminer un tableau emprunté à la vie abjecte et en faire un chef-d’œuvre ; ils nient qu’un puissant éclat de rire vaille un beau mouvement lyrique et qu’un abîme le sépare de la grimace des histrions ! Niant tout cela, les détracteurs tourneront en dérision les mérites de l’écrivain méconnu ; nulle voix ne répondra à la sienne ; il demeurera isolé au beau milieu du chemin. Austère est sa carrière, amère sa solitude. Quant à moi, je le sais, une puissance supérieure me contraint à cheminer longtemps encore côte à côte avec mes étranges héros, à contempler, à travers un rire apparent et des larmes insoupçonnées, l’infini déroulement de la vie. Le temps est encore lointain où l’inspiration jaillira à flots plus redoutables de mon cerveau en proie à la verve sacrée, où les hommes, tremblants d’émoi, pressentiront les majestueux grondements d’autres discours... En route, en route ! Déridons notre front ; plongeons-nous dans la vie, son fracas, ses grelots, et voyons ce que fait Tchitchikov.» 207 De l'humanité pour ces moujiks disparus ... et les femmes ! «Quand il considéra ensuite tous ces petits feuillets, ces paysans qui avaient été naguère des êtres de chair et d’os, peinant, labourant, charriant, s’enivrant, trompant leurs maîtres — ou de simples braves gens peut-être — un étrange sentiment, que lui-même n’aurait su définir, s’empara de lui. Chaque liste semblait avoir un caractère particulier et le communiquer aux moujiks qui la constituaient. Ceux de madame Korobotchka étaient presque tous affublés de sobriquets. La concision distinguait la note de Pliouchkine : des initiales suivies de deux points y figuraient le plus souvent les prénoms. Le relevé de Sobakévitch frappait par l’abondance des détails ; il relatait toutes les qualités des moujiks. Tel nom était suivi de la mention : bon menuisier ; tel autre de celle-ci : intelligent et point ivrogne. Il n’avait garde d’omettre les noms et la conduite des père et mère d’un chacun ; seul un certain Fédotov portait comme signalement : né de père inconnu et de la fille de chambre Capitoline, mais honnête et de bonnes mœurs. Tous ces détails donnaient aux paperasses une fraîcheur spéciale ; ces braves gens ne semblaient défunts que de la veille. Tchitchikov s’attendrit et s’écria en soupirant : — Mes bons amis, vous voilà réunis en nombreuse compagnie ! Quels étaient, mes bien chers, vos moyens d’existence ? Comment joigniez-vous les deux bouts ? Ses yeux s’arrêtèrent involontairement sur un nom, celui du fameux Piotr Savéliev Mets-les-pieds-dans-le-plat, ancien serf de madame Korobotchka. Cette fois encore, il ne put s’empêcher de dire : — Quel nom à n’en plus finir, il occupe toute une ligne ! Qui étais-tu, mon brave : artisan ou simple manant ? Sans doute es-tu mort au cabaret, à moins qu’un convoi de chariots ne t’ait écrasé tandis que tu dormais allongé au beau milieu du chemin ? — Bouchon Stépane, charpentier, de sobriété exemplaire. — Ah ! ah ! le voilà Stépane Bouchon, ce colosse qui eût fait merveille dans la garde ! Bien sûr, mon garçon, tu parcourais toutes les provinces, bottes sur l’épaule et cognée à la ceinture, en te nourrissant d’un liard de pain et de deux liards de poisson sec, pour rapporter, à chacune de tes tournées, une centaine de roubles-argent dans ta bourse, sans compter les assignats, que tu fourrais dans tes bottes ou dont tu faisais peut-être une doublure à ton pantalon de grosse toile ! Où diantre es-tu passé de vie à trépas ? Aurais-tu peut-être, pour augmenter tes gains, entrepris la réparation d’un clocher et, le pied te manquant, serais-tu venu t’écraser sur le sol, fournissant ainsi à quelque père Mikhéi l’occasion de se gratter la nuque en murmurant : « Eh, là ! mon gars ; qu’est-ce qu’il te prend !... » et de grimper aussitôt la corde aux reins à ta place ?... Maxime Téliatnikov, savetier. Ah ! bah, savetier ! Saoul comme un savetier, dit le proverbe russe. Je te connais, mon brave, et vais, si tu veux, te raconter ton histoire en peu de mots. Apprenti chez un Allemand — qui vous nourrissait tous à la même écuelle, vous reprochait votre négligence à coups de tire-pied sur le dos et vous défendait de polissonner dans les rues, — tu travaillais à merveille, et l’Allemand n’en finissait plus de chanter tes louanges à sa femme ou à son Kamerad. Ton apprentissage terminé, tu te dis : « Je m’en vais maintenant ouvrir boutique, mais au lieu de tirer, comme mon grigou d’Allemand, le diable par la queue, je ferai vite fortune. » Redevance payée à ton seigneur, tu te mis à l’œuvre et les commandes affluèrent. Tu achetas pour rien du mauvais cuir et réalisas sur chaque paire de bottes double bénéfice ; mais, au bout de quinze jours, elles étaient toutes crevées et tes pratiques te traitèrent de la belle manière. Ta boutique désertée, tu noyas le chagrin dans la boisson ; vautré dans la rue, tu déblatérais : « Le monde est mal fait. Les Russes ne peuvent plus gagner leur vie, il n’y en a que pour les Allemands ! » Mais quel est celui-ci : Moineau Elisabeth ! Une femme ? Que vient-elle faire ici ? Cette fripouille de Sobakévitch a pourtant trouvé moyen de me rouler ! Tchitchikov avait raison : c’était bien une femme, insérée dans la liste avec une astuce inouïe. Il fallut la rayer. — Grigori Va-toujours-et-tu-n’arriveras-pas ! Qui diantre as-tu pu bien être ? Un roulier, sans doute, qui, après avoir fait emplette de trois chevaux et d’une mauvaise patache, dit pour toujours adieu à son trou et s’en alla voiturer les marchands de foire en foire ? As-tu rendu ton âme à Dieu sur la grande route ? Tes amis se sont-ils défaits de toi pour l’amour de quelque grosse et rubiconde commère ? Tes moufles de cuir, tes bêtes trapues ont-elles tenté quelque coureur de bois ? Ou encore, rêvant dans ta soupente, n’as-tu pu résister au désir de te précipiter au cabaret, puis de là, tête baissée, dans la rivière, ni vu ni connu. Drôles de gens que nos Russes ; ils n’aiment pas à mourir de leur belle mort ! Et vous, mes beaux mignons, continua-t-il en reportant les yeux sur la feuille où étaient inscrits les serfs fugitifs de Pliouchkine ; vous vivez encore, c’est vrai, mais vous n’en valez pas mieux ! Où vous entraîne maintenant votre course rapide ? Meniez-vous vraiment chez Pliouchkine une si pénible existence ? Ou vous êtes-vous laissé tenter par la vie errante et trouvez-vous plaisir à écumer les grands chemins ? Croupissez-vous en prison, ou vous êtes-vous donnés à d’autres maîtres dont vous labourez les terres ? Iérémei l’Entêté, Nikita le Coureur, son fils Antoine le Coureur... À leurs surnoms on devine que ces deux-là s’entendent à jouer des jambes... Popov, domestique... Celui-là sait sans doute lire et écrire. Il ne joue pas du couteau et commet ses vols le plus honnêtement du monde. Mais on t’a pincé sans passeport et tu subis bravement l’interrogatoire du capitaine-ispravnik : « À qui es-tu ? demande celui-ci en ajoutant, à ton adresse, quelque mot bien senti. — À tel et tel seigneur, réponds-tu hardiment. — Que fais-tu ici ? reprend l’ispravnik. — J’ai un congé à redevance, affirmes-tu sans sourciller. — Ton passeport ? — Je l’ai remis à l’artisan Piménov, mon patron. — Faites entrer Piménov. C’est toi Piménov ? — C’est moi. — Ce garçon prétend t’avoir remis son passeport ? Est-ce vrai ? — Jamais de la vie ! — Alors tu as menti ? demande l’ispravnik en lançant un nouveau juron. — Tout juste, avoues-tu crûment ; je suis rentré trop tard et l’ai confié à Antipe Prokhorov, le sonneur de cloches. — Faites venir le sonneur... T’a-t-il remis son passeport ? — Pas du tout ! — Mais alors, tu as de nouveau menti ? s’emporte le capitaine-ispravnik en appuyant ses dires d’une bordée de gros mots. Voyons, où est ton passeport ? — J’en avais un, crânes-tu ; mais après tout, je l’ai peut-être bien égaré en route. — Et cette capote de soldat, reprend le capitaine-ispravnik, en te gratifiant à nouveau d’une flatteuse épithète, — et cette cassette contenant les économies du curé ; pourquoi les as-tu volées ? — Volées ! déclares-tu sans broncher. Je n’ai jamais encore exercé ce métier-là ! — Pourtant, c’est chez toi qu’on a trouvé la capote ; d’où provient-elle ? — Je n’en sais rien, quelqu’un l’y aura apportée. — Ah ! coquin ! dit le capitaine-ispravnik, hochant la tête et les poings aux hanches. Les fers aux pieds et en prison ! — Soit, comme il vous plaira ! » acquiesces-tu. Et, tirant ta tabatière, tu offres une prise aux deux invalides qui te rivent les fers, et t’informes aimablement de la date de leur congé et des campagnes auxquelles ils ont pris part. Te voilà sous clef ; la procédure suit son cours ; de Tsarévo-Kokchaisk on te transfère dans une autre ville, de là à Vessiégonsk ou ailleurs ; tu passes ainsi de prison en prison et dis en examinant ta nouvelle demeure : « Non, décidément, on se sentait plus à l’aise à Vessiégonsk et la société y était plus variée ! » Abachum Fyrov ! Où peux-tu bien flâner, frère ? Aurais-tu par hasard gagné la Volga, te serais-tu laissé tenter par la libre vie des haleurs ?... Tchitchikov interrompit son monologue et se prit à rêver. Songeait-il au sort d’Abachum Fyrov, ou évoquait-il simplement la large vie sans frein, rêve favori des Russes de tout âge, de tout grade, de toute condition ? Et de fait, où peut bien être Fyrov ? Sans doute a-t-il loué ses services à des gens de négoce et arpente-t-il maintenant, dans un joyeux vacarme, le port au blé. Fleurs et rubans au chapeau, les compagnons prennent un turbulent congé de leurs femmes ou maîtresses, belles gaillardes enrubannées, colliers au cou. Chants et danses s’entremêlent, tandis qu’au moyen de leurs crochets, les débardeurs chargent sur leur dos, avec force cris et jurons, jusqu’à des neuf pouds de pois ou de froment, qu’ils déversent bruyamment dans les profonds chalands ; des ballots d’avoine et de gruau jonchent le sol ; des pyramides de sacs s’entassent, comme des boulets, à perte de vue : formidable arsenal, destiné à disparaître aux flancs profonds des barges qui, dès la débâcle, descendront le fleuve à la queue leu leu. Quand cette interminable caravane se mettra en marche, votre heure sera venue, haleurs ! De franc cœur, comme naguère au plaisir, vous vous attellerez à la besogne, tirant, tirant le cordeau, aux accents d’une cantilène monotone et sans fin, comme toi, Russie !...» 303 Comment on reconnaît les services rendus par un soldat éclopé « ... après la campagne de 1812, le capitaine Kopéïkine faisait partie d’un convoi de blessés renvoyés dans leurs foyers. ... Figurez-vous que le gaillard perdit un bras et une jambe à Krasnoié ou à Leipzig ; je ne me rappelle plus au juste. En ce temps-là, savez-vous, on n’avait encore pris aucune disposition à l’égard des blessés : la caisse des Invalides ne fut, en quelque sorte, fondée que bien plus tard. Ce que voyant, le capitaine Kopéïkine se dit : « Pour le coup, il s’agit de travailler. » Malheureusement il ne lui restait que le bras gauche. Il essaya bien d’attendrir son bonhomme de père, mais le vieux lui dit tout net : « Je n’ai pas de quoi te nourrir, c’est à peine — figurez-vous ça — si je suffis à mes besoins ! » Alors, mon bon monsieur, le capitaine Kopéïkine décida de se rendre à Pétersbourg pour implorer un secours de l’empereur car enfin il avait, en une certaine mesure, versé son sang, sacrifié sa vie...Il trouva moyen de se faire voiturer dans les fourgons de l’intendance ; bref, voilà mon homme à Pétersbourg. Vous voyez d’ici mon farceur de Kopéïkine débarquant dans une capitale qui n’a pas, pour ainsi dire, sa pareille au monde. La vie, vous comprenez, s’offre à lui sous un jour nouveau ; il se croit transporté dans un conte de Shéhérazade ! Figurez-vous son étonnement devant l’avenue de la Neva ou encore, que le diable m’emporte, devant la rue aux Pois ou celle de la Fonderie ! Ici, une flèche qui se perd dans le ciel ; là, des ponts suspendus, sans point d’appui, pour ainsi dire : bref, mon cher monsieur, une vraie cité de Sémiramis ! Il songea tout d’abord à se meubler un appartement ; mais, là-bas, rideaux, draperies, tapis de Perse et toute la diablerie coûtent les yeux de la tête ; dès qu’on veut y toucher, on risque fort de se brûler les doigts. À Pétersbourg, on foule, en une certaine mesure, l’argent aux pieds. On sent en l’air comme un parfum de billets de mille. Et mon Kopéïkine ne possède pour tout potage qu’une dizaine de billets bleus et quelque menue monnaie. Impossible, n’est-ce pas, d’acheter une terre avec pareil pécule, à moins d’y ajouter quarante mille roubles que l’on emprunte au roi de France. Il s’en alla loger à l’hôtel de Revel pour un rouble par jour, dînant d’une soupe aux choux et de bœuf en boulettes... Le lendemain, monsieur, il décida de se présenter au ministre. — Il faut vous dire que l’empereur était absent de la capitale : l’armée n’était pas revenue de Paris[144]. S’étant donc levé de bon matin, il se racla le menton de la main gauche, pour éviter des frais de barbier, s’affubla de son uniforme et, trottinant sur sa jambe de bois, s’en fut incontinent trouver le ministre. Il s’enquit de l’adresse auprès d’un garde de ville. — C’est ici, répondit l’autre en désignant une maison sur le quai du Palais. Une chaumine, savez-vous : en guise de vitres, des glaces de cinq mètres, qui permettaient d’apercevoir de l’extérieur les vases et tout le mobilier ; on aurait cru n’avoir qu’à étendre la main pour s’en emparer ; et partout des marbres de prix, des laques..., en un mot, mon bon monsieur, c’était à en perdre la raison, le dernier cri du confort. À la vue des boutons de porte si propres, si luisants, on avait envie de courir acheter pour deux sous de savon et de se laver les mains pendant deux bonnes heures avant d’oser y toucher. Le suisse ressemblait à un généralissime : canne à pomme d’or, mise princière, jabot de batiste — un doguin engraissé... Mon Kopéïkine, toujours clopinant, se hissa tant bien que mal jusqu’à la salle d’audience, où il se blottit dans un coin, prenant bien garde à ne pas bousculer quelque Inde ou quelque Amérique — en porcelaine dorée, s’entend. Il va sans dire qu’il resta là longtemps, parce que le ministre venait à peine de se lever et que son valet de chambre lui apportait sans doute une cuvette d’argent pour ses ablutions. Mon Kopéïkine attendit ainsi quatre bonnes heures ; finalement, un aide de camp, ou quelque autre fonctionnaire de service, vint annoncer l’arrivée du ministre. À ce moment, comprenez-vous, les gens se pressaient dans la salle comme des fèves sur une assiette. Et je vous prie de croire que ce n’étaient point de pauvres diables comme nous, mais rien que des dignitaires de quatrième classe, des colonels s’il vous plaît, et même, de-ci de-là, des généraux, à en juger par la graine d’épinards des épaulettes. Soudain tout le monde s’agita ; des chut, chut, coururent par la salle ; et finalement régna un silence de mort. Entre le ministre... Un homme d’État, n’est-ce pas ? Les traits en harmonie avec le haut poste qu’il occupe... Tout le monde, bien entendu, rectifie la position. Chacun attend, en une certaine mesure, que son sort se décide. Il s’approche de l’un, de l’autre : « Que désirez-vous ? Quelle affaire vous amène ? » — Enfin le voici devant Kopéïkine. « Voyez-vous, dit notre homme, j’ai versé mon sang, perdu pour ainsi dire bras et jambes, et ne pouvant plus travailler, j’implore un secours de Sa Majesté. En voyant devant lui ce gaillard à la jambe de bois, une manche vide agrafée à l’uniforme : « Parfait, dit le ministre ; repassez dans quelques jours. » Trois ou quatre jours après, mon bon monsieur, il revient trouver le ministre... « Je suis venu m’informer, dit-il. Étant données mes infirmités, les blessures reçues, ayant, pour ainsi dire, versé mon sang... » — Et le reste à l’avenant, dans la forme voulue. Le ministre le reconnut aussitôt. « Ah ! dit-il, je ne puis encore rien vous dire. Attendez le retour de l’empereur. Des dispositions ne manqueront pas d’être prises à l’égard des blessés. Quant à moi, je ne puis rien faire sans l’ordre de Sa Majesté. » Il salua et passa outre. Mon Kopéïkine se trouva, vous comprenez, dans une drôle de situation, car enfin on ne lui avait dit ni oui, ni non. Cependant, comme bien vous pensez, la vie dans la capitale devenait de jour en jour plus onéreuse. « Eh ! songea notre homme, retournons chez le ministre ! Qu’avez-vous décidé, Excellence ? lui dirai-je, je mange mes derniers sous. Si vous ne me venez pas en aide, il me faudra, sauf votre respect, mourir de faim. » Aussitôt dit que fait : le voilà de nouveau au ministère. — « Le ministre ne reçoit pas aujourd’hui, lui objecte-t-on, repassez demain. » — Le lendemain, le suisse ne lui accorda même pas un regard. Le pauvre diable n’avait plus qu’un billet bleu en poche. Adieu la soupe et le bœuf ! il se nourrissait maintenant d’un hareng, d’un concombre salé et de deux liards de pain. Et le cher homme était doué d’un appétit de loup. Représentez-vous mon Kopéïkine passant devant un traiteur : le chef, un Français, à la physionomie ouverte, au linge de Hollande, au tablier blanc comme neige, prépare une omelette aux fines herbes, des côtelettes aux truffes et autres bons morceaux, auxquels le lascar eût volontiers fait un sort. Le voilà devant le marché Milioutine ; aux vitrines s’étalent des saumons, des cerises à cinq roubles pièce, une pastèque monstre, grosse comme une diligence, semblant attendre au passage l’imbécile qui en donnera cent roubles. Tout cela lui fait venir l’eau à la bouche : à chaque pas une tentation. Mettez-vous à sa place ! D’un côté pastèque et saumon ; de l’autre le mets plein d’amertume qui a nom demain. Enfin le pauvre diable n’y tient plus : il décide de parvenir coûte que coûte jusqu’au ministre. Il attend à la porte l’arrivée d’un autre solliciteur et réussit, vous comprenez, à se faufiler en compagnie d’un général dans la salle d’audience. Le ministre fait son entrée comme à l’ordinaire. — Que désirez-vous ? Et vous ?... Ah bah ! fait-il en apercevant Kopéïkine, vous revoilà ! Ne vous ai-je pas expliqué que vous deviez prendre patience ? — Faites excuse, Excellence, mais il ne me reste plus, en une certaine mesure, de quoi manger. — Je n’y puis rien ; tâchez, en attendant, de vous trouver quelques moyens d’existence. — Comment le pourrai-je, Excellence, puisque je n’ai plus pour ainsi dire ni bras ni jambe ? Il voulait ajouter : « Quant à mon nez, il ne peut servir qu’à me moucher : encore pour cela faudrait-il acheter un mouchoir. » — Mais le ministre, mon bon monsieur, soit qu’il en eût assez, soit qu’il fût vraiment occupé de graves affaires d’État, commença pour de bon à se fâcher. — Retirez-vous, lui dit-il. Vous n’êtes pas le seul dans votre cas. Attendez patiemment ! Alors, mon Kopéïkine — que la faim, vous comprenez, aiguillonnait : — Comme vous voudrez, Excellence ! Du coup, le ministre, figurez-vous, sortit des gonds ! De fait, depuis que le monde est monde, on n’avait jamais vu un Kopéïkine s’aviser de parler sur ce ton à un ministre. Jugez un peu de ce que doit être la colère d’un ministre, d’un homme d’État pour ainsi dire : — Insolent, s’écria-t-il. Je vais vous trouver une résidence. Holà ! Un courrier, et qu’il emmène ce drôle ! Et le courrier, comprenez-vous, se trouvait déjà derrière la porte : un escogriffe haut de six pieds, figurez-vous ; de grosses pattes de voiturier ; une carrure de dentiste !... Voilà notre homme installé sur une charrette, le courrier à côté de lui. « Au moins, se dit-il, je n’aurai pas de relais à payer ; c’est toujours ça de gagné ! » Et, tout en roulant avec son garde du corps, il ronchonnait à part soi : « Ah, ah ! tu veux que je me trouve des moyens d’existence ! Parfait, parfait, je les trouverai ! » Et bien, figurez-vous, que personne ne sait au juste où l’on emmena mon Kopéïkine : le gaillard sombra totalement dans le fleuve d’oubli, dans le Léthé comme l’appellent les poètes.» Lecture juin 2023 Haut de page Page en amont Des visites régulières de ces pages mais peu de commentaires. Y avez-vous trouvé ou proposez-vous de l'information, des idées de lectures, de recherches ... ? Y avez-vous trouvé des erreurs historiques, des fautes d'orthographes, d'accords ... ? Ce site n'est pas un blog, vous ne pouvez pas laisser de commentaires alors envoyez un mail par cette adresse robertsamuli@orange.fr Au plaisir de vous lire. |